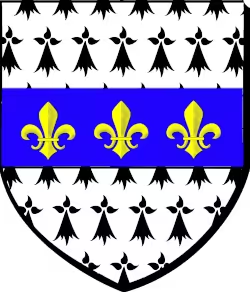⌘ Gâvre et prisonniers allemands
En ces temps de guerre, tous les hommes jeunes ou dans la force de l'âge envoyés aux Armées, la forêt du Gâvre était plutôt à l'abandon et les bois manquaient dans le département. Il fut décidé d'employer des prisonniers allemands aux travaux forestiers et ces hommes d'entretenir et rentabiliser les 4.464 hectares de cette forêt aménagée en futaie de 180 ans de révolution. Trois essences principales peuplent cette futaie: le chêne pour 80%, le hêtre et pin sylvestre pour 10% chaque.
En ce début 1915, les stocks de bois de chauffage du département de Loire-Inférieure, actuelle Loire-Atlantique, sont épuisés ou presque: les boulangers ne pouvaient chauffer leurs fours ; cela posait multiples problèmes qui ne pourraient que s'amplifier. L'exploitation de la forêt du Gâvre présentait moult avantages: la proximité du canal de Nantes à Brest ainsi que les lignes de chemin de fer de Rennes à Nantes et de Châteaubriant à Saint-Nazaire.
◎ Les prisonniers s'installent
C'est le 11 mars que fut autorisée l'exploitation des futaies par les prisonniers, une cinquantaine d'hommes dont le nombre ira croissant et atteindra 500 hommes en mars 1916.
L'hébergement des premiers travailleurs de la troupe germanique se fit au rond-point de l'Étoile dans une écurie qui avait été cédée à la concession des chasseurs de la forêt ; la garde fut hébergée dans un petit pavillon proche ; il était propriété de l'administration. La construction de barages fut confiée à une équipe de prisonniers étant charpentiers ; ils construisirent de nouveaux baraquements en fonction des besoins.
Les baraques étaient d'un type normalisé. Toutes faisaient 11 mètres de long sur 7,20 de large. 50 hommes y logeaient, encadrés par 2 sous-officiers. Les fondations furent réalisées en des solins en parpaings de ciment et machefer de 0,50 x 0,25 x 0,20 jointés à la chaux. Ces solins recevaient la charpente ; des chevrons de 0,15 x 0,15. Des voliges constituaient murs et toiture ; ils étaient recouverts de carton bitumé. Une porte de 2 x 2 mètres ouvrait le pignon sur l'extérieure et une fenêtre ajourait la pièce sur l'autre pignon ; elle faisait 2 x 1 mètre, à 1 mètre du sol et fermetures extérieures. 12 vitres éclairaient la baraque et 2 manches à air la ventilaient. Des tables et bancs étaient installés dans un passage central ayant 3 mètres de largeur. Le couchage se faisait sur lits en rondins superposés dont le plus bas, à 50 cm du sol et le plus haut à 2.25m pour une largeur de 78cm par homme. Les sous-officiers étaient séparés de la troupe par une cloison. Chaque baraque était équipée d'un poêle, de casiers personnels, de lampes à pétrole et d'un extincteur.
Chaque baraque coûta la modique somme de 860 Francs.
En 1916; la forêt voyait 2 cantonnements: l'un situé au rond-point de l'Étoile accueillait 200 prisonniers ; l'autre, près du Carrefour de Néricou, voyait 300 prisonniers y séjourner.
C'est le 11 mars que fut autorisée l'exploitation des futaies par les prisonniers, une cinquantaine d'hommes dont le nombre ira croissant et atteindra 500 hommes en mars 1916.
L'hébergement des premiers travailleurs de la troupe germanique se fit au rond-point de l'Étoile dans une écurie qui avait été cédée à la concession des chasseurs de la forêt ; la garde fut hébergée dans un petit pavillon proche ; il était propriété de l'administration. La construction de barages fut confiée à une équipe de prisonniers étant charpentiers ; ils construisirent de nouveaux baraquements en fonction des besoins.
Les baraques étaient d'un type normalisé. Toutes faisaient 11 mètres de long sur 7,20 de large. 50 hommes y logeaient, encadrés par 2 sous-officiers. Les fondations furent réalisées en des solins en parpaings de ciment et machefer de 0,50 x 0,25 x 0,20 jointés à la chaux. Ces solins recevaient la charpente ; des chevrons de 0,15 x 0,15. Des voliges constituaient murs et toiture ; ils étaient recouverts de carton bitumé. Une porte de 2 x 2 mètres ouvrait le pignon sur l'extérieure et une fenêtre ajourait la pièce sur l'autre pignon ; elle faisait 2 x 1 mètre, à 1 mètre du sol et fermetures extérieures. 12 vitres éclairaient la baraque et 2 manches à air la ventilaient. Des tables et bancs étaient installés dans un passage central ayant 3 mètres de largeur. Le couchage se faisait sur lits en rondins superposés dont le plus bas, à 50 cm du sol et le plus haut à 2.25m pour une largeur de 78cm par homme. Les sous-officiers étaient séparés de la troupe par une cloison. Chaque baraque était équipée d'un poêle, de casiers personnels, de lampes à pétrole et d'un extincteur.
Chaque baraque coûta la modique somme de 860 Francs.
En 1916; la forêt voyait 2 cantonnements: l'un situé au rond-point de l'Étoile accueillait 200 prisonniers ; l'autre, près du Carrefour de Néricou, voyait 300 prisonniers y séjourner.
Nous avons description de ces deux cantonnements:
- Le cantonnement de Néricou
Il s'étend sur 5.525 mètres carrés et se compose de 11 baraques dont 4 servent de logement et bureau pour le chef de détachement, le poste de police de la garde, les magasins, le réfectoire, l'infirmerie et la prison. 6 baraques sont réservées pour les 300 prisonniers, leurs cuisines, douches, latrines - couvertes et séchoirs. Le dernier baraquement sert de boulangerie et nous y trouvons le four, ainsi les réserves de farines et pains destinées aux prisonniers et à la garde.
La garde est assurée par un adjudant commandant 2 sous-officiers, 8 caporaux et 70 soldats.
- Le cantonnement du rond-point de l'Étoile
D'une superficie de 4.000 m², il comprend un logement pour les sous-officiers et la garde, ainsi que bureau, cuisine, magasin. Quatre bâtiments sont réservés aux 200 prisonniers et six hangars qui y voient installés les cuisines, ateliers de cordonnerie et réparations, les établis et les séchoirs ; une infirmerie et uneprison sont installés dans une des baraques. Un relatif confort existe: des lavabos à réservoirs avec robinets, des douches, des latrines couvertes à tinettes y sont installés.
◎ Les prisonniers au travail
Sur 500 prisonniers de guerre, 400 furent assignés à éclaircir les parcelles de feuillus et réalisèrent les stères destinées à l'armée ; les 100 autres étant chargés de réaliser des cotrets et fagots, pour les villes de Nantes et Saint-Nazaire.
Le rendement fut faible au départ mais augmenta avec régularité pour atteindre une stère / homme / jour comme minimum exigé par l'administration.
L'état sanitaire des prisonniers était bon dans son ensemble et le nombre de malades peu élevé. Les statistiques nous indiquent que 80% des prisonniers étaient au travail ; ceci en ayant déduit les hommes distraits du service par les corvées et tâches diverses non liées à l'exploitation forestière.
◎ Logistique
Les bois exploités étant destinés à l'Armée ainsi qu'aux villes de Nantes et Saint-Nazaire, il fallait les transporter à destination. Une brigade de prisonniers fut décidée et assignée à cette tâche. Ils furent installés dans la gare de La Maillardais située sur la ligne Rennes-Nantes.
L'administration des Eaux et Forêts fit construire 2 écuries de 15,20m sur 8,40m pour y loger la brigade de chargement, soit 60 hommes et leurs 42 chevaux. Les hommes logeaient au-dessus d'une écurie ; l'autre grenier servant aux fourrages. Le montant de ces baraquements s'éleva à 1.475 Francs.
- Les bois pour l'Armée
Ils étaient récupérés sur les sites de coupes par les soins de l'intendance puis transportés par charrois vers la gare de La Maillardais pour être expédiés par voie ferrée vers Nantes.
- Les bois destinés aux civils
Formés de fagots, aussi appelés cotrets, ils étaient expédiés vers Nantes via le canal de Nantes à Brest. 4 chevaux militaires ainsi que leurs palefreniers et conducteurs amenaient les bois destinés à Nantes de la forêt jusqu'aux péniches. Ils logeaient rond-point de l'Étoile dans une écurie leur étant réservée ; elle avait coûté 1.225 francs. Les bois destinés à Saint-Nazaire étaient dirigés vers la gare de Blain par voituriers locaux.
◎ Rentabilité
Les prix de ventes étaient de 12 Francs la stère et 65 francs le cent de fagots. Chaque jour et en moyenne, les brigades de prisonniers expédiaient 150 stères pour l'Armée, 1.000 cotrets à Nantes et 150 fagots à Saint-Nazaire. L'administration des Eaux et Forêts calcula le bénéfice de ces livraisons qui s'élevait à 2,20 francs par stère et 9,50 Francs par centaine de cotrets.
◎ Bilan
Le bilan de cette exploitation fut positif et eu impact sur la hausse des prix.
- Les menues brindilles
Elles furent laissées aux indigènes en échange de journées de travail ; cela leur permettant accès à des bois pour faible coût.
- Les bois de l'Armée
L'accès aux bois devenant difficile, une augmentation des prix se fit lourdement ressentir et, à la création du camp, les tarifs atteignaient 20 Francs la stère, l'Armée réalisera alors un bénéfice de 8 Francs / stère.
- Les bois pour Nantes et Saint-Nazaire
L'envoi de bois permit de retrouver les prix d'avant-guerre et stoppa l'envolée des prix du pain. Cette exploitation de la forêt eut aussi impact sur les autres départements et communes de Loire-Inférieure - Loire-Atlantique, qui purent garder à usage personnels les bois ménagers qui auraient alors fait défaut.
- Les Eaux et Forêts
Ils soulignèrent la bienveillance rencontrée pour appuyer leur initiative et firent remarquer l'asuilibre qu'ils avaient apporté entre les impératifs culturaux; sociétaux et militaires.
◎ Des photographies